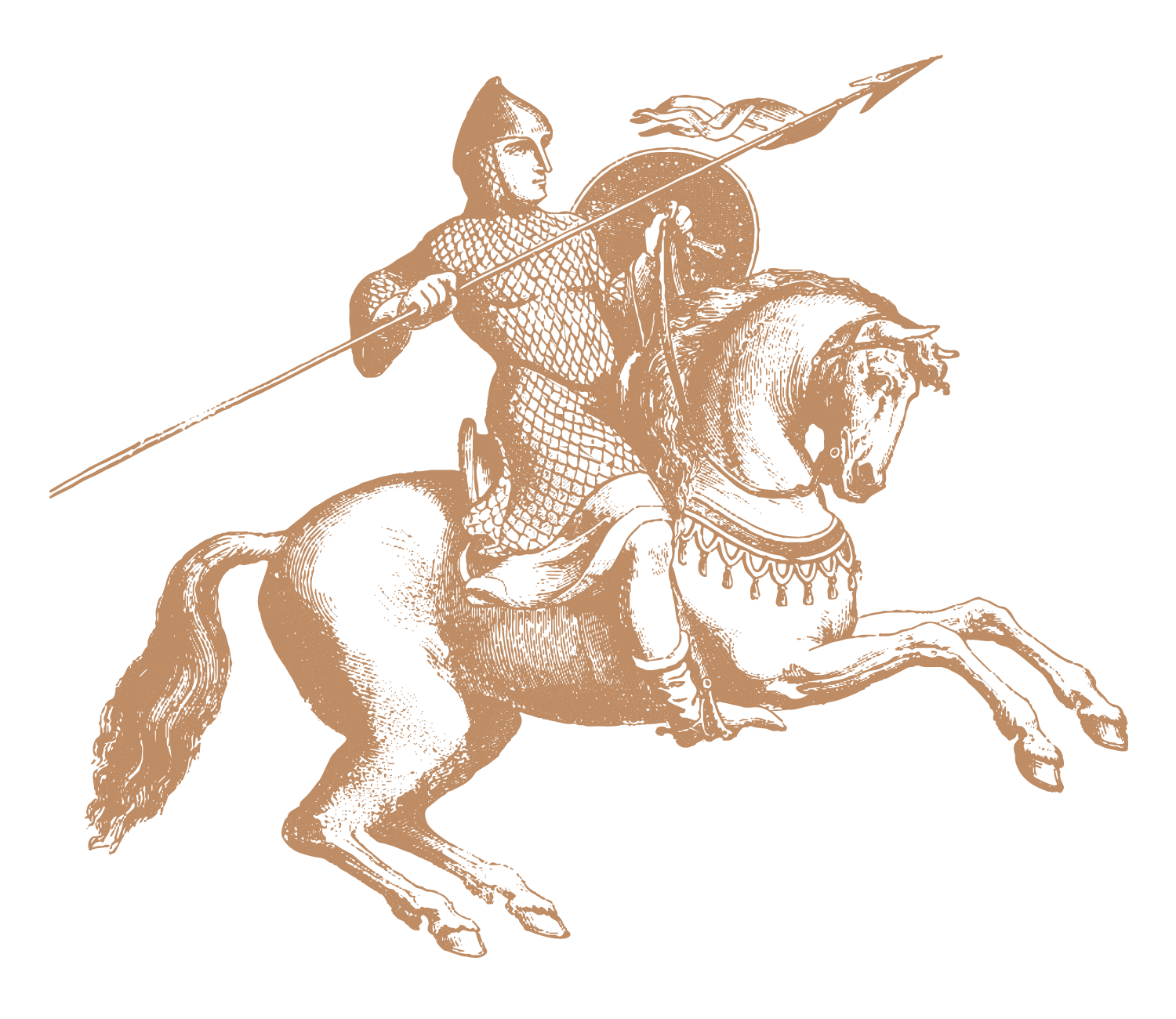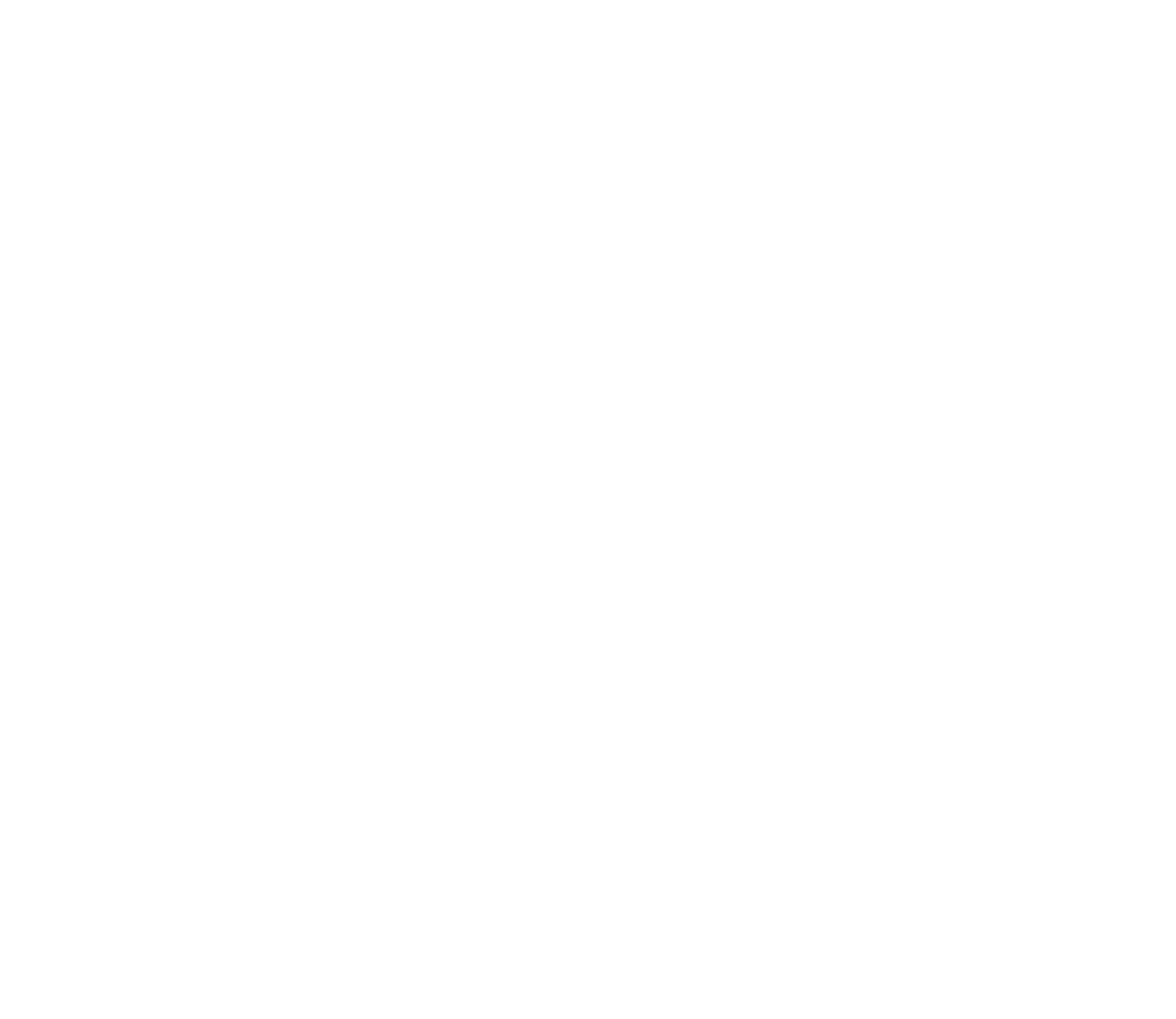Tradition in construction from 1990. with more than 300 clients.
Histoire du parc
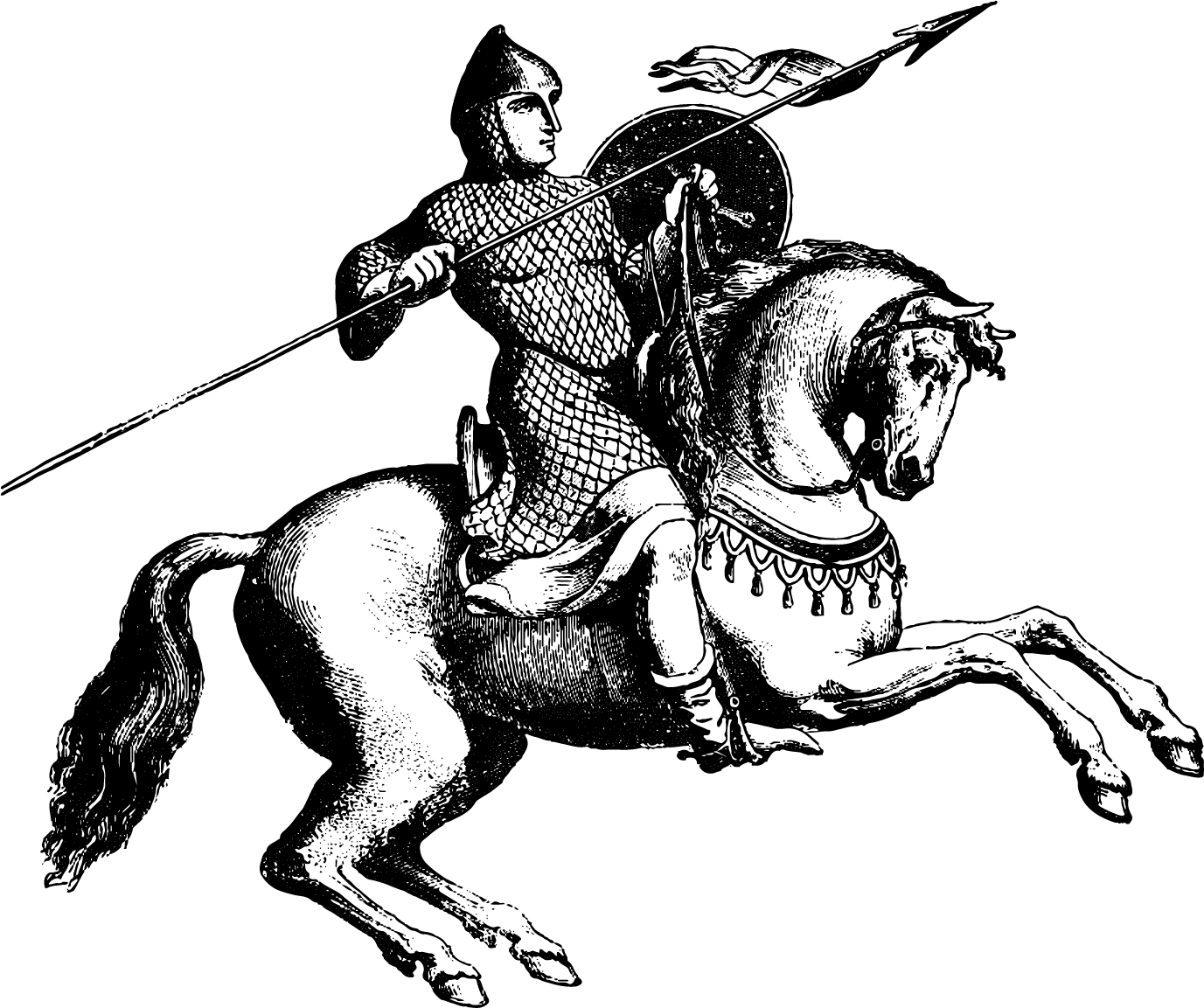
Le Manoir du Parc dans l’Histoire.
Par Jean Barros.
Le site
Le Parc d’Ourville est situé sur la commune de Saint-Lô d’Ourville ( Canton de Barneville-Carteret, communauté de communes de la Côte des Isles) à 250m de la limite de cette commune avec celle de Canville-la-Rocque (canton de La Haye du Puits) et à 700 mètres à vol d’oiseau du château d’Olonde.

Les origines
En l’absence totale d’archives, on ne sait rien du Parc l’annexion de la Normandie par le roi de France Philippe Auguste (1204). Par contre, il est remarquable que l’on connaisse, sans interruption, la succession des propriétaires du Parc depuis le début du XIIIème siècle jusqu’à nos jours.
Nous ne retiendrons pas, faute de preuves, les assertions de Robert Asselin, l’érudit historien de Port Bail, qui, dans le bulletin paroissial de Port Bail, attribue la possession du parc , avant 1204, à la famille d‘Aubigny. Cet auteur ne cite pas ses sources et nous n’avons rien trouvé permettant de confirmer ce qu’il avance.
Le toponyme « Le Parc » suggère l’existence d’un parc seigneurial à l’époque médiévale.
Les parc étaient de vastes étendues fermées par des haies épaisses et des fossés ou des clôtures de palis. Ces espaces clos, d’une superficie allant de 50 à 250 Ha, tenus par de grands féodaux laïcs ou ecclésiastiques, proches du pouvoir royal ou ducal, étaient consacrés à l’élevage d’animaux domestiques (chevaux, bovins, moutons, chèvres,…) ou de gibiers (cerfs, biches, daims, sangliers). Cette diversité de peuplement animal impliquait l’existence de secteurs boisés, de prairies et de zone inondables
Au delà de la toponymie, la situation de l’actuel domaine du Parc par rapport à celui d’Olonde (voir fig.2) suggère l’hypothèse suivante : à l’origine, l’actuel domaine du Parc d’Ourville, pour sa plus grande partie, était le Parc seigneurial du Château d’Olonde. Il en aurait été détaché pour constituer le domaine réservé d’un nouveau fief noble crée au profit d’un cadet de famille.
On ne connaît pas la date de ce démembrement qui a pu avoir lieu entre 1205, année où Philippe-Auguste, nouveau maître de la Normandie, donna Olonde à son fidèle serviteur Richard d’Argences (1) et 1220, année où le registre des fiefs de Philippe-Auguste (2) nous apprend que Guillaume d’Argences tenait la quatrième partie d’un fief de chevalier prés d’Olonde : « Guillemus ex Argentis tenet quartam partem unius féodi militis apud Orlandam. » Ce quart de fief de chevalier était le Parc, bien qu’il ne soit pas nommément désigné. Ce même Guillaume d’Argences possédait alors Ollonde : « Guillemus de Argentis tenet inde de dono regis orlandam que excidit domino Regi que debet servicium dimidi feodi »
On notera qu’Olonde relevait aux XIe et XIIe siècles de l’Honneur du Plessis (3) et que le plus ancien aveu du roi pour le fief du Parc (1403) mentionne que son possesseur doit au roi le service, au château du Plessis, d’un homme armé pendant dix jours (4). La coïncidence n’est peut-être pas fortuite.
Les limites conjecturales du Parc d’Olonde, dont la superficie pouvait être de 63 Ha environ, sont indiquées sur la figure 3 (5).
Les clôtures en sont encore aisément repérables sur le terrain. En particulier (voir fig. 1) :
- La Pièce de la Coudrière est en fait un double talus avec de profonds fossés. Il s’agit d’une « double haie » constituée de deux levées ou banques de terre parallèles portant chacune une rangée d’arbres entre lesquels est aménagé un passage.
- La Croûte (aujourd’hui la chasse) et le Plant sont bordés, en limite de l’ancien Parc, par un talus dont les dimensions (hauteur 2,40m, largeur à la base de 5 mètres, largeur au sommet de 4m) sont de beaucoup plus importantes que celles rencontrés traditionnellement dans le secteur (voir figure 4 et 5). On est en présence « d’une double haie » à une seule banque de terre dont la largeur au sommet assurait un étroit passage entre deux rangées d ‘arbres utilisables par les piétons et plus exceptionnellement les cavaliers. Les arbres de haut jet et les cépées ont disparu et il ne reste qu’un mauvais taillis.
Le toponyme « La Haute Porte » situe l’entrée du Parc seigneurial. Une autre entrée devait probablement exister prés du château d’Ollonde.
Les toponymes : La pièce du Bois, Le Bois, Le Pré du Bois, Le petit Bois aujourd’hui dans le domaine d’Olonde pour une superficie d’environ 14 Ha sont une « relique » de la partie boisée de l’ancien parc seigneurial.
Le Parc seigneurial d’Olonde n’a donc pas survécu, en tant que tel, au-delà du début du XIIIème siècle.
(1) Léopold Delisle, cartulaire normand de Philippe-Auguste, n°121.
(2) Mémoires de la société des Antiquaires de Normandie, volume XV, 1846, P.168
(3) Thomas Stapleton, Magni rotuli Scaccarrii Normanniae sub regibus angliae, Londres, 1840, p. clxxxvii et sq.
(4) Aveu de Collibeaux de Criquebeuf (23 novembre 1403), Archives Nationales, Paris, cote P/289/4.
(5) Selon Marie Casset, Les Parcs sont de formes elliptiques afin d’enclore une grande superficie avec un minimum de clôture (M. Casset, un mode de gestion de l’espace rural : les parcs à gibier en Normandie au moyen-âge).
(6) selon Marie Casset, les parcs sont de formes elliptiques afin d’enclore une grande superficie avec un minimum de clôture (M. Casset, un mode de gestion de l’espace rural : les parcs à gibier en Normandie au moyen-âge.
Les seigneurs du Parc d’Ourville.
- d’Argences
- d’Estouteville (branche cadette de Criquebeuf)
- d’Argouges
- de Clamorgan
- de la Rivière
- de Thieuville
- de Pierrepont
- de Thère
- d’Osmond-Médavy
- de Mauconvenant de Sainte-Suzanne
d’Argences (XIIIème et XIVème siècles).
« de gueules à la fleur de lys d’argent »
Cette famille tient son nom de la terre d’Argences qui est son fief d’origine. Argences est situé à 11km à l’est de Caen, prés de la RN13.
Les membres de cette famille qui ont possédé le fief du Parc d’Ourville nous sont connus par les dotations qu’ils ont faites aux abbayes de Lessay et Blanchelande (1).
En 1224, Guillaume d’Argences donne à l’Abbaye de Lessay 5 quartiers de froment à prendre sur ses moulins d’Olonde à Canville, de Grye et du Dicq à Portbail.
En 1220, il est cité comme possesseur d’Olonde et du Parc dans le registre des fiefs de Philippe-Auguste.
En 1219, il avait confirmé la donation faite à l’abbaye de Blanchelande par Gilbert Malesarz du fief de Grye à Portbail, Gouey, à Saint-Maurice et au Mesnil.
En 1234, Roger d’Argences, chevalier, renonce, en faveur des religieux de Lessay, au droit de patronage de l’Eglise d’Ourville et Richard de Sienne (de Sena), nommé par les religieux à la cure de l’église peut en prendre libre possession (2). Roger d’Argences ne pouvait prétendre au droit de patronage de l’église d’Ourville qui appartenait à l’abbaye de Lessay depuis sa fondation.
Guillaume d’Argences, fils Guillaume Santon, moine de Lessay résidant au manoir de la baronnie d’Avarville à Ourville, divers tènements de fiefs (1243) et 10 quartiers de froment de rente sur son moulin de Hardoin avec les fiefs de Raoul Cour et Pierre Abe, d’Ourville (1244).
En 1275 et 1279, Pierre d’Argences, frère de Robert, était seigneur du Parc d’Ourville.
Roger et Colin d’Argences rendent aveu au roi, en 1300, pour le fief du Parc d’Ourville (3)
En 1376, fut mis en jugement, en l’Echiquier de Normandie, un procès entre Roger d’Argences, prêtre, seigneur du Parc d’Ourville et le prieur de Portbail au sujet du droit de varech et épaves sur le rivage de Portbail (4)
C’est la dernière mention connue de la présence de la famille d’Argences au Parc d’Ourville.
- (1) A.D. Manche, série H, fonds détruits en 1944, inventaires sommaires imprimés.
- (2) A. D. Manche, H6255.
- (3) A.D. Manche, A2336, fonds détruits en 1944, inventaire sommaire imprimé.
- (4) A.D. Manche, H6503, Livre des Fieux du Prieuré de Portbail, fonds détruits en 1944. Des extraits du livre des fieux ont été publiés par R. Asselin dans le bulletin paroissial de Portbail.
Les Familles d’Estouteville, d’Argouges, de Clamorgan, de la Rivière (XVème siècle-début XVIème siècle)
On ne sait quand et dans quelles circonstances le Parc d’ourville cessa d’appartenir à la famille d’Argences.
Collibeaux de Criquebeuf rendit aveu au roi pour le Parc d’Ourville, le 14 novembre 1403. Il était membre de la célèbre famille d’Estouteville.
Les armes d’Estouteville sont « Burelé d’argent et de gueules de 10 pièces au lion de sable brochant sur le tout, armé, lampassé et couronné d’or ».
Henri d’Estouteville (…1205-1218…) épousa Mahaut alias Mathilde d’Eu. Ils eurent deux fils : Jean, auteur de la branche aînée, et Robert, auteur de la branche cadette des seigneurs de Criquebeuf-en-Caux prés de Fécamp.
L’arrière petit-fils d’Henri d’Estouteville et de Mahaut d’Eu, Collard d’Estouteville, fils de Pierre, seigneur de Criquebeuf, et d’Alix de Gal, épousa Alix d’Argences, fille de Robert, seigneur d’Argences, et de Jeanne de la Serre d’où sont issus :
Guillaume, aîné, chevalier, seigneur de Criquebeuf , Chamelles et de la Serre.
Collibeaux d’Estouteville (alias Collibeaux de Criquebeuf)
Seigneur de Criquebeuf, Chamelles et de la serre (à la suite de son frère aîné Guillaume)
Il épousa Jeanne de Missy dame de Missy, Brucourt, du Han, d’Anneville et du Parc, fille de Colin de Missy et de Guillemette Suhart (1)
Collibeaux de Criquebeuf est du nombre des 119 chevaliers de la garnison du Mont-Saint-Michel qui, sous les ordres de Louis d’Estouteville, résistèrent aux Anglais (en 1417, Henri V d’Angleterre débarque à l’embouchure de la Touques, en moins de deux ans il reprend toute la Normandie sauf le Mont-Saint-Michel qui restera imprenable).
Collibeaux de Criquebeuf était devenu seigneur du parc par son mariage avec Jeanne de Missy, dame du Parc et autres lieux. Il en rendit aveu au roi de France en 1403. A la suite des événements qui aboutirent à la reconquête de la Normandie par les Anglais (1417-1419), Henri V d’Angleterre confisqua le fief du Parc et le donna à Jehan d’Argouges à cause de la rébellion (c’est-à-dire la fidélité au roi de France) de Collibeaux de Criquebeuf.
Jean d’Argouges, sieur d’Argouges–en-Bessin (2), la Champagne, Gratot, Beaumont, Cosqueville, était le fils de Philippe d’Argouges et de Marguerite de la Champagne (tous deux sont inhumés dans l’église de Gratot). La sœur de Jean d’Argouges, Catherine, épousa Thomas de Clamorgan, seigneur de Saint-Pierre –Eglise. Tous tenaient le parti d’Henry V d’Angleterre. Jean d’Argouges avait épousé Charlotte de Carbonnel, dame de Cérences (Jehan d’Argouges, mort le 17 novembre 1465, est inhumé dans l’abbaye de Longues. Charlotte de Carbonnel, morte en 1474, est inhumée dans l’église de Gratot).
Le 31août 1429, un accord passé entre Jean d’Argouges et Thomas de Clamorgan fut confirmé à Vernon par l’oncle du roi Henry V d’Angleterre, Jean, régent du royaume de France et Duc de Bedford. Par cet accord, Jean d’Argouges quitta, transporta et délaissa le fief du Parc à Thomas de Clamorgan, son beau-frère.
Les armes d’Argouges sont : « écartelé d’or et d’azur à trois quintefeuilles de gueules brochant sur le tout »
Thomas de Clamorgan, cinquième du nom ; de la branche des seigneurs de Rauville-la-Place et Saint-Pierre-Eglise joua un certain rôle pendant la fin de la guerre de Cent-ans. Il s’était rallié aux Anglais et reçut de nombreux fiefs en Cotentin. Il fut vicomte de Coutances (…1424-1430…) et de Valognes (1429-1433) sous la domination anglaise.
En 1436, il fut maintenu dans la possession de ses biens propres par le roi de France Charles VII, mais tenu de restituer à leur anciens propriétaires les biens que les anglais lui avaient concédés. Cependant, il était encore seigneur du Parc en 1438, année où il rendit aveu pour ce fief. En cette même année 1438, il est dit seigneur du Parc dans un document concernant les salines de Portbail et conservé dans les archives du Dicq de Portbail (chartrier du château de Sainte-Suzanne).
Les armes des Clamorgan sont : « d’argent à l’aigle éployé de sable becquée et armée d’or ».
Le fief du Parc fut restitué aux enfants de Collibeaux de Criquebeuf :
Simon d’Estouteville, seigneur de Criquebeuf, Chamelles, Missy, Brucourt, du Han, d’Anneville et du Parc.
Perrette d’Estouteville, dame de Criquebeuf, Chamelles, Missy, Brucourt, du Han, d’Anneville et du Parc.
Perrette d’Estouteville, dame du Parc et autres lieux, épousa Richard de la Rivière, seigneur de Gouvis (Gouvix, prés de Bretteville-sur-Laize, Calvados).
La famille de la Rivière est originaire de Saint-Germain-du-Crioult (Calvados, à 4,5km à l’ouest de Condé-sur-Noireau et 5,5 km à l’est de Vassy).
Plusieurs membres de cette famille se sont distingués dans les armées du roi de France pendant la guerre de Cent-Ans.
Les armes de la Rivière sont : « d’argent à trois tourteaux de sable, 2 et 1 ».
Bertrand de la Rivière, fils de Richard et de Perette d’Estouteville, seigneur du Parc, Anneville, Criquebeuf, la Fère, Missy et Saint-Germain du Crioult (…1451-1482…) fut reconnu noble à Ourville (Saint-Lô d’Ourville) par Montfaut en 1463. Il épousa Jeanne de Briqueville, fille de Roger, seigneur de Laune (3)
Leur fils, Jacques de la Rivière, seigneur du Parc et Anneville, épousa Marguerite du Mesnildot. Les armes de la famille Mesnildot sont « d’azur au chevron d’argent accompagné de trois croix d’or, 2 et 1 ». Elles figurent dans la Chapelle du Parc d’Ourville.
De Jacques de la Rivière et Marguerite du Mesnildot est issu :
François de la Rivière, seigneur du Parc (aveu du 15 avril 1514) qui produit sa généalogie le 14 juillet 1523 à Valognes :
« C’est la déclaration de noble Me François de la Rivière, sieur du Parc.
« Dit que noble homme Richard de la Rivière, seigneur du Parc, d’Anneville, Criquebeuf et de la Fière, et de dlle Jeanne de Missy, yssit noble Me Bertran de la Rivière, sieur desdits lieux et outre, de Brucourt, Missy et Saint-germain du crioult, qui espousa dlle Jeanne de Briqueville, fille de Noble et puissant seigneur Messire Roger de Briqueville, chevalier, seigneur de Laune.
« Dont yssit Noble Me Jacques de la Rivière, sieur du Parc et d’Anneville, marié à dlle Marguerite du Mesnildot, fille du sieur de Mesnildot, de Mirville et Magneville. Desquels est yssu ledit François de la Rivière déposant, sieur du Parc, lequel et ses prédécesseurs sont extraictz de noble et ancienne lignée et ont servy le Roi et antiennement les ducs de Normandie, tant en leur ordonnances qu’arrières-baon (4). Et offre soutenir estre yssu et descendre ledit déposant des lignées d’Argences et d’Estouteville, et à ce droit porte les armoiries desdites lignées et noblesse.
« Produit au greffe lesd. Jour et an dessusdits.
« [Et porte ledit seigneur de la Rivière : d’argent à 3 tourteaux de sable chargeant un écartelé d’Argences et d’Estouteville] »
D’après cette généalogie, Jeanne de Missy serait l’épouse et non pas la belle-mère de Richard de la Rivière ce qui apparaît peu vraisemblable.
On ne sait quand et dans quelles circonstances le Parc passa de la famille de La Rivière à celle de Thieuville.
A propos de la famille de la Rivière, on retiendra que :
François de la Rivière, demeurant à Saint-Sauveur-de-Pierrepont, est cité dans la Recherche de noblesse de Roissy (8 janvier 1599, à Saint-Lô). Il déclara « être en procès aux Aides (5) pour sa noblesse ». Nous ne savons à quelle branche de la famille de La Rivière le rattacher.
Deux arrières petits fils de Richard de la Rivière, seigneur du Parc, Jacques (né vers 1636) et Nicolas (né vers 1640) sont cités dans la recherche de noblesse de Chamillart (1666) : « Jacques et Nicolas de la Rivière, écuyers, sieurs de Gouvix et du Mesnil-Salle, demeurant en la paroisse de Saint-Germain-de-Crioult, sergenterie de Vassy, élection de Vire, 30 et 27 ans. Religion Réformée ».
François de la Rivière, seigneur de Romilly (6), lieutenant général du Vicomte de Bayeux (mort le 13 septembre 1557 et inhumé dans la collégiale Saint-Nicolas-des-Courtils) qui avait épousé Jacqueline de Cossé (morte le 23 décembre 1584), auteur de la branche des seigneurs de Romilly, des Hérils et Crèvecoeur (cités dans la recherche de noblesse de Chamillart)
et
François de la Rivière, seigneur du Parc, qui produit sa généalogie le 14 juillet 1523 à Valognes, ne peuvent, faute de preuves et sous réserve de la découverte de documents probants, être considérés comme une seule et même personne.
- (1) d’Où sont issus Simon et Perrette d’Estouteville dont il sera question plus loin (Missy : canton de Villers-Bocage. Calvados)
- (2) à Vaux-sur-Aure, prés de Bayeux, Calvados
- (3) Laulne, canton de Lessay.
- (4) ordonnances (compagnies d’ordonnance) : compagnies non rattachées à un régiment.
Ban et arrière-ban : corps de la noblesse convoqué à la guerre par le roi. - (5) Cour des Aides : juridiction jugeant en dernier ressort et en toute souveraineté tous les procès en matière fiscale.
- (6) Il y a 2 communes de ce nom dans l’Eure : Romilly-la-Puthenaye et Romilly-sur-Andelle.
Les Familles de Tieuville, de Pierrepont et la descendance en ligne féminine des Pierrepont.
La recherche de noblesse de d’Aligre (1634) nous renseigne sur la nouvelle lignée des seigneurs du Parc, les Thieuville dont les armes sont « d’argent à deux bandes de gueules cotoyées de sept coquilles de même posées deux, trois et deux » (1) :
« 437. Jacques de Thieuville, escuyer, sieur du Parc, de la paroisse de Saint-Lô d’ourville, élection de Valognes, fils Charles, fils Gilles, fils Guillaume, fils Nicolas de Thieuville, escuyer, sieur du Parc, arrest de la Cour des Aydes du 17ième juin 1606 avec le procureur général par lequel ledit Jacques est maintenu en sa qualité de noble, jouira ».
Nous ne savons rien de Nicolas, Guillaume et Gilles de Thieuville sinon qu’ils ont été, selon déclaration ci-dessus, seigneurs du parc.
Les archives du Dicq de Portbail, conservées dans le chartrier du château de Sainte-Suzanne-en-Bauptois, éclairent d’un jour curieux la personnalité de Charles de Thieuville (…1576-1599…) :
Les sieurs du Dicq (Pierre du Castel) du Parc d’Ourville (Charles de Thieuville), « gentz d’armes seigneuriaulz, craintz et redoutés et en armes et en loix, apparentés aux juges du pays et usant de leur autorité », extorquèrent sous la menace de Nicolas de Clamorgan, seigneur de Saint-Georges-de-la-Rivière, homme « viel et décrépit, agé de 80 ans et plus, sur le bord de la fosse, qui le rendoit plus aise à intimider », deux contrats par lesquels il reconnaissait leur abandonner 20 vergers des meilleurs terres asséchées de la mare Saint-Georges ainsi que le droit de gravage et de mielles.
D’autre part, les « pauvres habitants de ce village de Saint-Georges », qui avaient perdu l’usage des milles pour faire pâturer leurs bêtes, renoncèrent, par crainte des sieurs du Dicq et du Parc.
Le 30 Août 1582, Nicolas de Clamorgan adressa une supplique au parlement. Le roi, en son conseil privé, accorda la Mare Saint-Georges, les droits de gravage et de mielle à leurs légitimes propriétaires : Nicolas de Clamorgan et son fils Nicolas.
Charles de Thieuville eu deux fils : Jean, probablement l’aîné, et Jacques qui produisit sa généalogie lors de la recherche de noblesse de 1634.
En 1602, Jean de Thieuville était décédé car Jacques de Thieuville fait aveu pour le fief du Parc au roi comme tuteur de la fille de Jean de Thieuville.
Le 11 février 1613, Jacques de Thieuville, écuyer, sieur du parc, rendit aveu pour le fief du Parc qu’il tenait du roi sous la châtellenie et vicomté de Valognes (2). Il avait épousé Marie Le Lièvre.
L’état de la noblesse de 1640 nous renseigne en ces termes sur le seigneur du Parc :
« Jacques de Thieuville, escuyer, sur du Parc. Homme vieil, a ung filz propre à servir, riche de 3000 livres tournois de rente ».
Ce fils propre à servir (dans les armées royales) était Guillaume Alexandre de Thieuville qui, en 1646, était sieur d’Ourville à cause de son fief du Parc.
Guillaume Alexandre de Thieuville décéda probablement sans postérité car le mariage, en 1626, de Marie de Thieuville, fille de Jacques , avec François de Pierrepont fit passer le Parc dans cette famille qui avait pour arme « d’azur à 3 pals d’or (3) au chef de gueules ».
François de Pierrepont, fils de Jacques de Pierrepont, sieur de Pierrepont, Ecaulleville et de la Motte, et de Jeanne Jouhan, est cité dans la recherche de noblesse de d’Aligre (1634) :
« 343. François de Pierrepont, sieur du lieu, de la paroisse de Saint-nicolas de pierrepont, fils Jacques, fils Guillaume, fils Jean, fils autre Jean, fils Robert, fils Jean de Pierrepont ».
Il est également cité dans l’état de noblesse de 1640 :
« François de Pierrepont, frère (4) du sieur de Baudreville (5) ; homme qui peut servir, riche de 3000livres tournois de rente »
du mariage de François de Pierrepont et Marie de Thieuville, sont issus :
1. Robert de Pierrepont, seigneur de Baudreville, lieutenant des gardes du corps et gouverneur de l’île de Ré, qui épousa Anne d’Héricy, décédée à Creullet (Creully, Calvados) le 19 avril 1675. Il décéda en 1681 à Baudreville, sans postérité.
2. Jacques Alexandre de Pierrepont, qui suit.
3. François-Jacques de Pierrepont (vers 1648-1712), chevalier, bachelier de Sorbonne, seigneur et patron de Beauchamps, du Mesnil Rogues, Pierrepont, la Gaselière et Ecaulleviller. Il résidait habituellement au Mesnil-Rogues et avait épousé Claire d’Astorg de la Perrère. Il mourut sans postérité en laissant ses biens à ses neveux (6)
Jacques Alexandre de Pierrepont, chevalier, châtelain du Parc d’Ourville et sieur d’Ourville (7), né vers 1640, mort en 1697. En 1679, il demeurait à Saint-Nicolas de Pierrepont.
En décembre 1687, il obtient « la constitution du plein fief de haubert de Baudreville par la réunion des fiefs du Parc d’Ourville, de Vesly (à Saint-Lô d’Ourville), de l’Hommée (à Canville) et de Baudreville ». A notre avis, cette réunion de fiefs (prélude à une érection en terre de dignité qui n’a jamais eu lieu) doit coïncider avec l’achèvement du château de Baudreville (dont il ne reste aujourd’hui que les douves et un portail d’entrée fin XVIIème siècle) ; elle semble d’ailleurs avoir été provisoire puisque ses enfants se partageront les éléments de ce fief le 3 octobre 1699 (8)
D’après d’autres sources (9), c’est en 1695 que le roi accorda des « lettres d’union des fiefs de Baudreville, du Parc d’Ourville, Vesly et l’Homme, terre et moulins y contenus, pour composer à l’avenir qu’une seule et même terre sous la dénomination de Terre de Pierrepont ».
Jacques Alexandre de Pierrepont épousa Catherine du Fay, fille de Gilles du Fay, sieur de Fergetot, Graimbouville, Prétot, la Brière et Boisjourdain (1614-1666) chevalier de Malte et maréchal de Bataille dans l’armée de Malte, maître de camp d’un régiment d’infanterie en 1637, et de Madeleine de Fouilleuse (10). Les armes de la famille du Fay sont : « de gueules à la croix d’argent contournée de quatre molettes du même ».
Jacques Alexandre de Pierrepont décéda peu avant le 24 février 1697. Le 3 octobre 1699, ses héritiers se partagèrent ses biens. (11). Sa veuve, Catherine du Fay, obtint « pour ses soins et usufruit tant à droit de douaire que d’acquest et conquest suivant la coutume… le fief noble et seigneurie du Parc » avec manoir, colombier, moulin banal et chapelle.
Catherine du Fay vint habiter au manoir du Parc qu’elle loua à des fermiers (12) et décéda entre le 11 octobre 1710 et le 3 juillet 1711 (13).
Du mariage de Jacques Alexandre de Pierrepont et Catherine du Fay sont nés cinq enfants, quatre fils morts sans postérités et une fille :
1. Robert de Pierrepont, « marquis de Pierrepont », seul de sa famille à prendre ce titre, baron haut-justicier de Lieurey (Eure) du chef de sa mère (14, seigneur et patron de Saint-Nicolas de Pierrepont, Baudreville, Ourville, Beauchamps, Vesly (à Saint-Lô d’Ourville), enseigne aux gardes françaises (en … 1697-1699…), demeurant au château de Baudreville.
Il se maria deux fois (15)
le 2 juin 1729, avec Anne-Victoire de Saint-Chamans, fille de François, marquis de Méry (en Limousin) et de Bonne de Chastelus, décédée le 15 mai 1734.
Le 20 mars 1738, avec Angélique Marie de Surirey de Saint-Rémy, fille de Michel, trésorier général des Ponts et Chaussées de France, et de Marie-Louise Vacheret.
Il décéda après 1751, sans postérité.
2. François Jacques, sieur de l’Hommée (l’Hommey). Le 8 juillet 1706, les membres de la famille réunis « à la présence et réquisition » de Robert, marquis de Pierrepont, Ourville, Baudreville, et de Charles de Pierrepont, « en conséquence de la sentence rendue au siège du baillage de Valognes en mars dernier par laquelle a été ordonné, en conséquence des faiblesses dans lesquelles ledit seigneur de l’Hommey est retombé, que ses parents paternels et maternels sont appelés à délibérer sur la curatelle dans laquelles il a été mis provisoirement en conséquence d’une sentence d’une sentence rendue au baillage de Valognes, le 6 juillet dernier » nommèrent curateur principal Charles de Pierrepont et pour curateur actionnaire le seigneur marquis de Pierrepont aîné.
Le sieur de L’Hommée fut conduit « chez les pères de la Charité de Pontorson » (16).
3. Jean-Louis, chevalier, capitaine au régiment Royal-Comtois, mort avant 1697.
4. Charles, chevalier non profès de Saint-Jean-de-Jérusalem (ordre de Malte), seigneur du fief de Pirou sis aux paroisses de Neufmesnil, Varanguebec et Bolleville. En 1706, il demeurait à Valognes et ,en 1711, au château de Beauchamps, chez son oncle, François-Jacques, seigneur de Beauchamps et du Mesnil-Rogues.
5. Catherine Thérèse
Fut élevée au Mesnil-Rogues, chez son oncle François Jacques de Pierrepont. Elle épousa Jean Antoine de Thère, chevalier, comte de Thère, seigneur d’Esglandes, Saint-Pierre d’Arthay, fils de feu noble seigneur Gédéon de Thère, vivant chevalier, « seigneur desdites terres », et de noble dame Renée Clérel de Rampan (17).
Le contrat de mariage fut passé le 4 juillet 1711 par devant Me Jean Birette, notaire royal en la vicomté de Valognes pour le siège de Sortosville-en-Beaumont.
La dot de la future épouse était de 45000 livres dont 30000 livres données par Robert, marquis de Pierrepont (25200 livres) et Charles de Pierrepont (4800 livres), ses frères qui, pour assurer l’équivalent de cette somme, cédèrent aux futurs époux le fief de Vesly (à Ourville), la terre de Gennetot (à Ourville et Gouey), les moulins d’Ourville et plusieurs pièces de terre sises à Ourville (succession de leur père et mère).
François Jacques de Pierrepont, oncle de la future épouse, « seigneur et patron et chastelain de Beauchamp, Mesnil-Rogue, Eculleville, Folligny, La Gaselière et autres lieux… pour la bonne amitié qu’il a pour ldite damoiselle de Pierrepont et en faveur de son mariage avec ledit seigneur d’Esglandes », lui donna 200 livres de rente raquitable pour 4000 livres « à prendre sur tout les biens dudit seigneur donateur et spiécialement sur la terre d’Ecauleville située dans la paroisse de Saint-Nicolas de Pierrepont ». Cette rente devait prendre effet à partir du jour du décès du donateur et de son épouse.
Le mariage fut célébré le 8 juillet 1711, en la chapelle du Parc d’Ourville. De ce mariage sont issus :
1. Michel Antoine de Thère, mort jeune.
2. Charles François de Thère, né vers 1715, décédé à Valognes le 2 octobre 1764, par son père comte de Thère, seigneur et patron d’Esglandes, Saint Pierre d’Arthenay et Eroudeville ; par sa mère seigneur de Baudreville, Le Parc, Ourville, Saint-Nicolas de Pierrepont, Ecaulleville, Beauchamp et Mesnil-Rogues ; Il épousa, le 21 mars 1732, Marie Marguerite Rose de Harcourt, fille Guillaume de Harcourt (1674-1745), capitaine des vaisseaux du roi et gouverneur du château de Saint-Sauveur–le-Vicomte, baron d’Olonde, seigneur et patron de Saint-Maurice en Cotentin et du Valdecie, et de Marie-Anne-Rose Poërier de Taillepied (18). D’où :
1. Rose Guillemette (alias Guillemine) Thérèse de Thère, qui suit.
2. Charlotte Rose Françoise de Thère, dame de Thère, Desglandes et Eroudeville (née en 1736) épousa en 1758, à Thère, Jacques-Adrien-Henry Dambray, écuyer, seigneur de Montigny (né en 1723, mort avant 1774), lieutenant des vaisseaux du roi. Postérité.
3. Marie-Rose-Jacqueline, née en 1739.
Rose Guillemette Thérèse de Thère (née en 1733, inhumée dans l ‘église de Valognes le 31 janvier 1767), dame de Baudreville, Ourville, du Parc, Saint-Nicolas de Pierrepont, Ecaulleville, Pirou, Beauchamps et Mesnil-Rogues, épousa à Valognes, le 5 juillet 1756, haut et puissant seigneur Barnabé-Louis-Gabriel d’Osmond-Médavy, originaire de Saint-Gervais au diocèse de Sées, chambellan de SAR Mgr le duc d’Orléans, fils de Messire Eustache comte d’Osmond et de Marie Mouise de Pardieu. Il fut présenté au roi par le duc d’Orléans le 7 juillet 1763 à Versailles.
Du mariage de Rose Guillemette de Thère et de Banabé-Louis-Gabriel d’Osmond Médavy sont issus :
1. Anne-Eustache-Charlotte-Rose d’Osmond-Médavy, qui suit
2. Charlotte Rose Jacqueline d’Osmond (née en 1764, décédée en Suisse entre septembre 1792 et le 6 novembre 1793) époux (contrat du 2 avril 1780) Christophe-Joseph de Malbec de Montjoc de Briges (1761-1795), d’où postérité de Briges, Lecourtois de Sainte-Colombe, de la Gonnivière et Doynel de la Sausserie (19)
Anne-Eustache-Charlotte-Rose d’Osmond, dame de Saint-Nicolas-de-Pierrepont, Ecaulleville, Ourville, Le Parc, ect, baptisée à Valognes le 4juin 1757, décédée le 20 août 1813, au château de la Bretonnière, à Golleville. Elle épousa Adolphe-Charles de Mauconvenant, chevalier, marquis de Sainte-Suzanne, fils de René-Jacques-François Bonaventure de Mauconvenant, écuyer, sieur de Peseville, seigneur et patron de Sainte-Suzanne, et de Marthe Bonaventure Helloin, né et baptisé à Sainte-Suzanne le 12 juillet 1743, décédé à Valognes le 7 octobre 1829, qui fut le dernier seigneur du Parc d’Ourville.
Leur fils unique, Louis Adolphe, baptisé à Valognes le 2 janvier 1780, y décéda le 23 janvier suivant.
Elle décéda à Golleville le 20 août 1813 et fut inhumée dans le cimetière de cette commune au nord de l’église où son tombeau existe encore aujourd’hui.
Le dernier seigneur du Parc d’Ourville, Adolphe-Charles de Mauconvenant, marquis de Sainte-Suzanne embrassa la carrière militaire. Il débuta le 6 juillet 1756 comme enseigne au Royal régiment des vaisseaux. Il fut nommé lieutenant le 11 septembre 1758 après l’affaire de Saint-Cast (20). En janvier 1761, il passa au régiment lieutenant-colonel de dragons dont il devint l’un des premiers capitaines en 1771. Il prit sa retraite en 1774 avec le brevet de colonel et fut décoré de la croix de chevalier de Saint-Louis en 1775.
Partisan des idées nouvelles, il fut élu maire de Golleville en 1790, mais, devant la tournure que prenait les événements, il abandonna la charge de maire et reprit du service en 1792 dans le « Corps à cheval de la province de Normandie » (Armée des Princes), passa à Jersey en 1793, devint officier au régiment à « Cocarde Blanche et du dresnay ». En 1798, il fut nommé au grade de maréchal de Camp (21).
Etant épouse d’émigré, Anne-Eustache-Charlotte-Rose d’Osmond-Médavy fut arrêtée sur ordre de le Carpentier (22) en vertu de la loi des suspects, le 24 thermidor an II (11 août 1794) et elle divorça pour éviter la confiscation de ses biens au profit de la Nation.
Le 4 brumaire an VII (25 octobre 1798) par devant Me Langlois, notaire à Valognes, elle vendit sa propriété du Parc d’Ourville à Jean-François Coquoin, domicilié à Bricquebec, pour le prix de 40000 francs et vingt pots de froment (23).
La tourmente révolutionnaire passée, les deux anciens époux se présentèrent devant le maire de Golleville, le 11 prairial an X (31 mai 1802) qui procéda à un remariage, un nouveau contrat de mariage ayant été passé devant Me Mauger, notaire à Saint-Sauveur–le-Vicomte, le 7 prairial an X.
Devenu veuf (Anne-Eustache-Charlotte-Rose d’Osmond-Médavy était décédée le 20 août 1813 à Golleville), le marquis de Sainte-Suzanne épousa en seconde noces, le 26 septembre 1814, Angélique-Jeanne de Montmort de Beaurains (1785-1841) veuve de Louis-Bon-Jean de la Couldre de la Bretonnière (24)
Après la chute de Napoléon 1ier, il fut l’un des premiers à prêter serment de fidélité aux Bourbon et, après l’assassinat du Duc de Berry (1820), il adressa au président du conseil des ministres une lettre le priant « de mettre aux pieds du Roi et des Princes de sa famille, l’expression de sa juste indignation, de la profonde douleur que nous inspire cet abominable forfait… »
Il possédait une belle fortune et lui ont appartenu :
Le château de la Bretonnière à Golleville, acquis pour 160 000 livres, en 1778, Bernard René Jourdan, marquis de Launay, gouverneur de la Bastille.
De 1782 à 1786, l’Hôtel Fouquet de Réville (depuis Hôtel du Campgrain ou de la Moissonnière), acquis le 12 juin 1782 de Paul-Hyacinthe-Charles de la Houssaye, marquis d’Ourville pour 23300 livres. Cet hôtel, qui était situé place des capucins à Valognes, a été totalement détruit en 1944.
En 1786, l’Hôtel Viel de Gramont (ou Gigault d’Hainneville ou de Sainte-Suzanne) par échange de son hôtel de la place des Capucins avec Louis-Bernardin Jacques Gigault de Bellefonds ((13 février 1786). Cet hôtel, situé 107-109 rue des Religieuses, a échappé aux destructions de 1944.
Enfin, toujours à Valognes, l’Hôtel de Cussy, ou de la Bretonnière, porte également le nom d’Hôtel de Sainte Suzanne. Il a appartenu à Louis-Bon-Jean de La Couldre de La Bretonnière, dont la veuve, Angélique-Jeanne de Montmort de Beaurains, épousa en deuxième noces Adolphe-Charles de Mauconvenant de Sainte-Suzanne (26 septembre 1814).
- (1) ces armes figurent dans la chapelle du Parc. Elles figuraient sculptées sur une pierre en calcaire d’Yvetot Bocage abandonnée dans les ronciers entre le logis et le pressoir. Elle a disparu avant l’arrivée de le famille Giard au Parc (1999)
- (2) vois en annexe
- (3) 7 bandes verticales or et azur
- (4) livre cousin
- (5) Jean de Pierrepont qui avait épousé, en 1619, Louise de Franquetot, fille d’Antoine, président au parlement de Rouen. Il est constructeur présumé de s châteaux de Baudreville et du Mesnil-Rogues, aujourd’hui pratiquement disparus.
- (6) Une recherche de noblesse, officieuse et inédite, de l’élection de Valognes (1679-1685) mentionne « François Jacques de Pierrepont, prêtre, dit » l’abbé de Pierrepont, frère du sieur d’Ourville. Mention vraisemblablement erronée (homonyme avec le n°3)
- (7) qualifié du titre de « sieur d’Ourville » en 1666 (ce millésime est lisible sur une poutre du grand logis du parc d’Ourville).
- (8) société d’Archéologie et d’Histoire de la Manche : Mélanges, 13ème série, 1984, p.71.
- (9) J.M. Renault, Notes historiques et archéologiques sur les communes de l’arrondissement de Valognes, canton de Barneville, Annuaire de la Manche, 1868 (notice sur Ourville, pp. 35-36) et Mémoires de la société des Antiquaires de Basse Normandie, t. XVIII, p.220.
- (10) H de Frondeville, Les présidents du Parlement de Normandie, Société de l’Histoire de Normandie, 1953.
- (11) Archives départementales de la Manche (5E11952), voir en annexe
- (12) voir en annexe les baux de 1703 et 1710
- (13) la perte de l’état civil ancien de Saint-Lô d’Ourville ne permet pas de préciser.
- (14) Catherine du Fay était la sœur de Jean-François du Fay, marquis de Vergetot et seigneur de Lieurey, marié sans postérité avec Louise Bernardine Gigault de Bellefonds, fille du maréchal Bernardin de Bellefonds
- (15) La Chesnaye-desbois, Dictionnaire de la noblesse, tome 15, colonne 848.
- (16) L’hôpital Saint-Antoine de la Charité de Pontorson avait été fondé le 3 février 1115 par les bourgeois de cette ville. Depuis 1644, il était tenu par les frères de l’ordre de Saint-Jean de Dieu, et ce jusqu’en 1792. Dés l’année 1700, l’hôpital reçu des « pensionnaires », fous ou insensés mais surtout « correctionnaires » (internés pour « dérangement de conduite »).
Sur cet établissement, voir H. Avisseau-Roussat, l’Hôpital Saint-Antoine de la Charité de Pontorson (1644-1792), Revue de la Manche, fasc. 22 et 23, 1964.
- (17) Jean Antoine de Thère était veuf de Barbe d’Anneville de Chiffrevast. Il mourut entre 1726 et 1728 au château de Thère.
- (18) Melle de Harcourt était, en 1730 , pensionnaire chez les Visitandines de Caen. Elle apporta 60000 livres en dot à son mariage.
- (19) voir, à ce sujet, Société d’Archéologie et d’Histoire de la Manche. Mélanges 13ième série, 1984, pp74-76
- (20) Le 11 septembre 1758, les troupes françaises commandées parle Duc d’Aiguillon, repoussèrent la tentative de débarquement des anglais commandés par l’amiral Howe. L’objectif de ce débarquement était vraisemblablement le prise de Saint-Malo. (guerre de Sept-Ans).
- (21) équivalent de l’actuel grade de général de Brigade.
- (22) Jean-Baptiste Lecarpentier (1759-1829), député de la Manche à la Convention (1792), représentant du peuple en mission dans la Manche (1793-1794).
- (23) A.D. Manche, notariat de Valognes, 5 E 15 112.
- (24) auteur du projet d’aménagement de la rade de Cherbourg (1778).